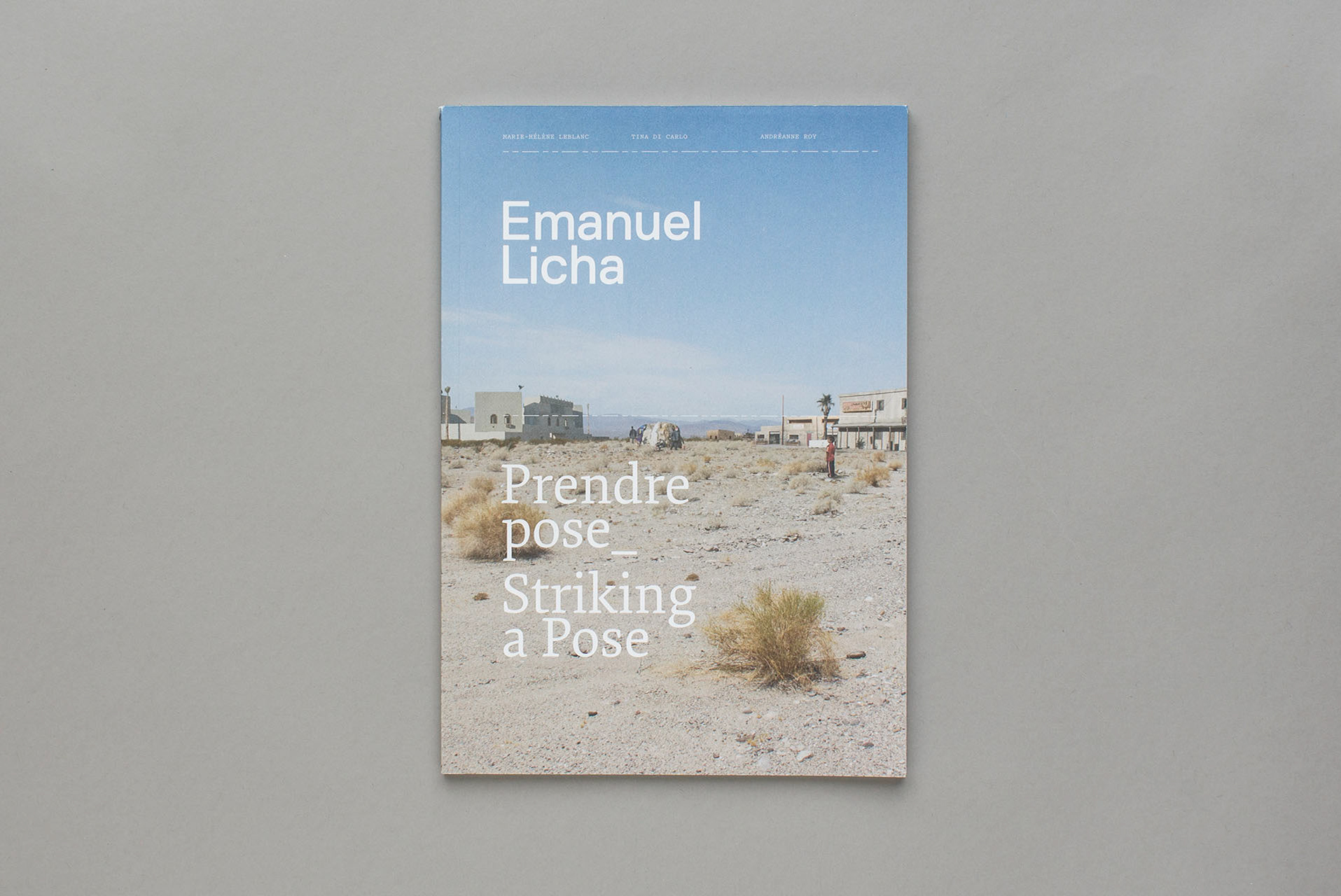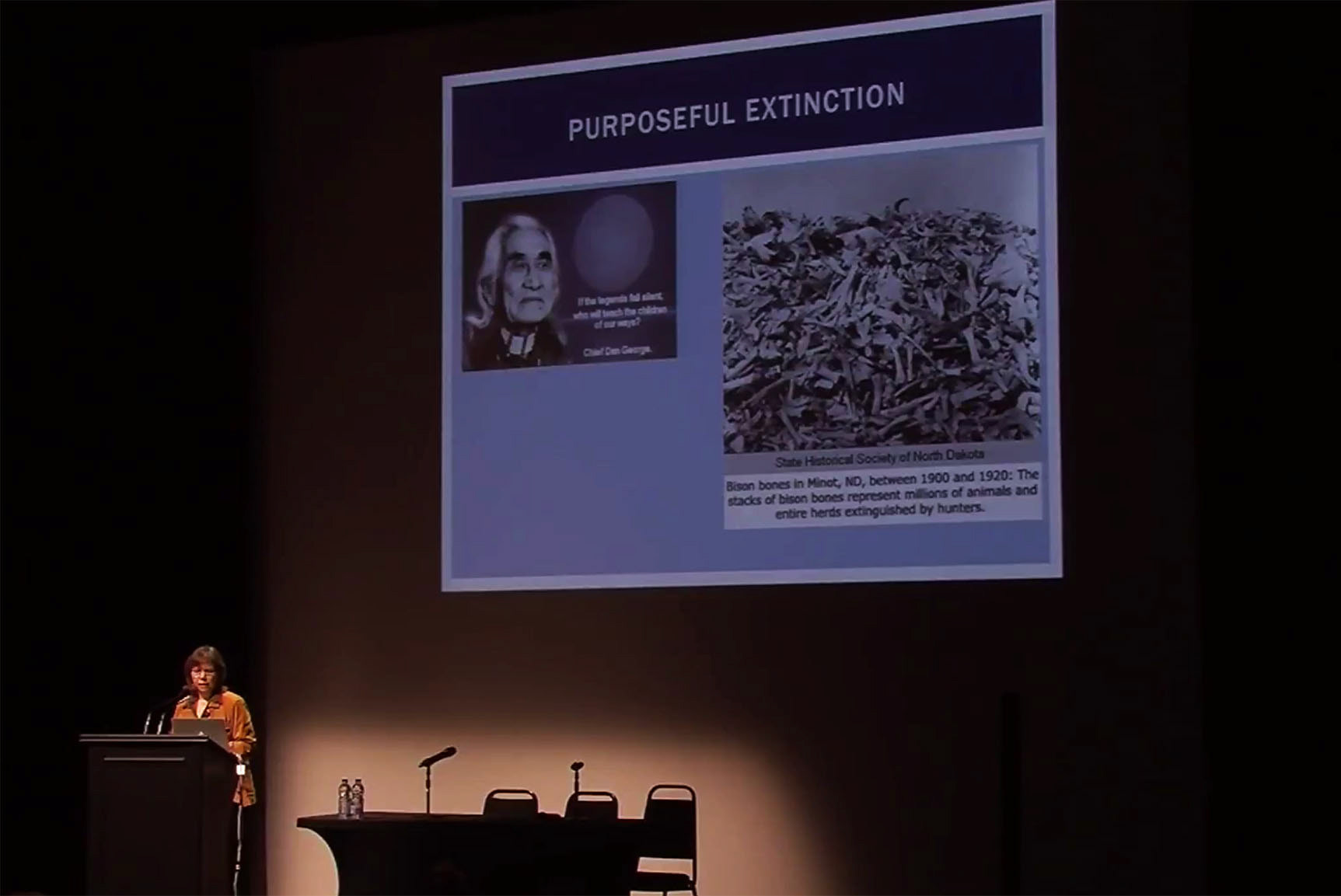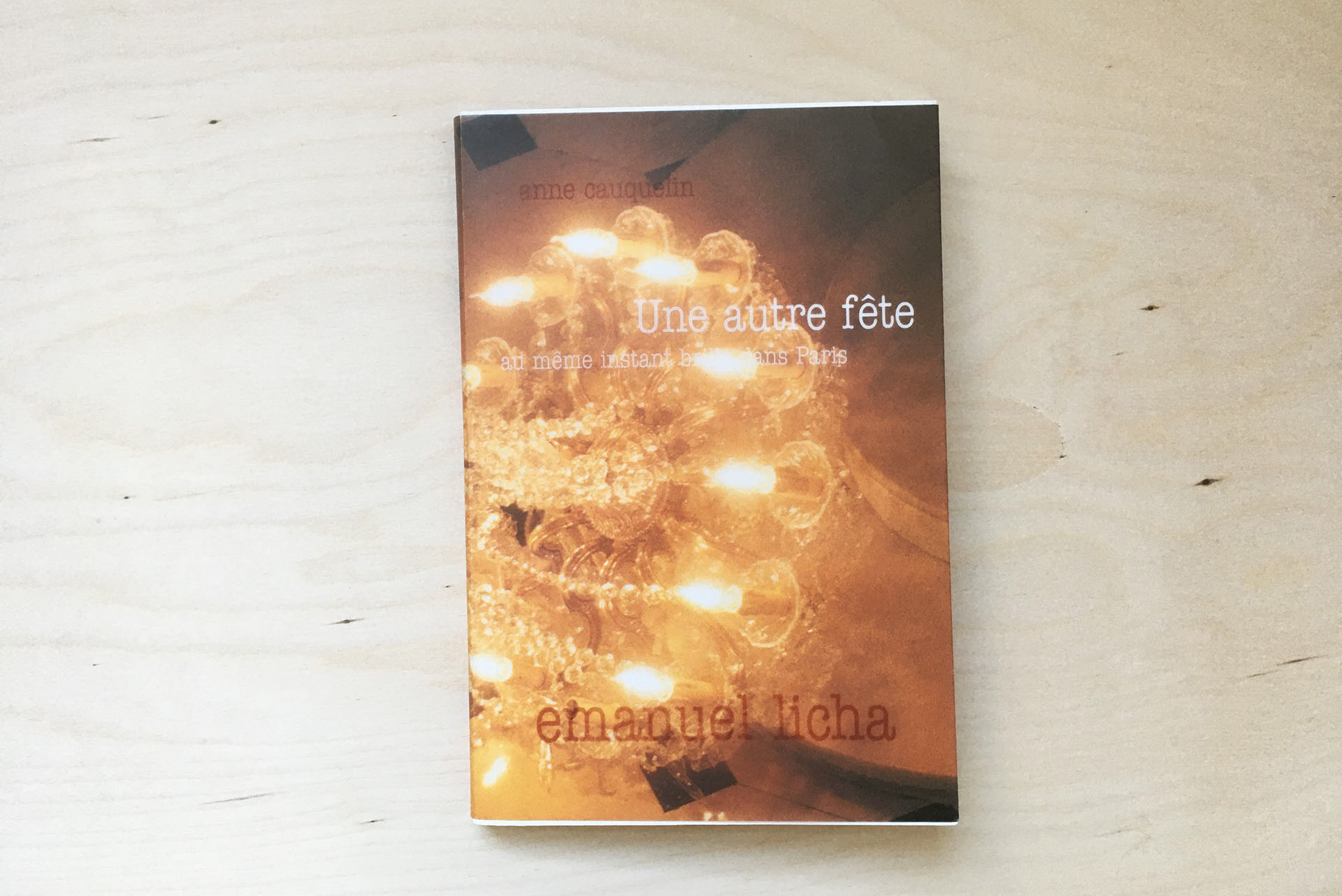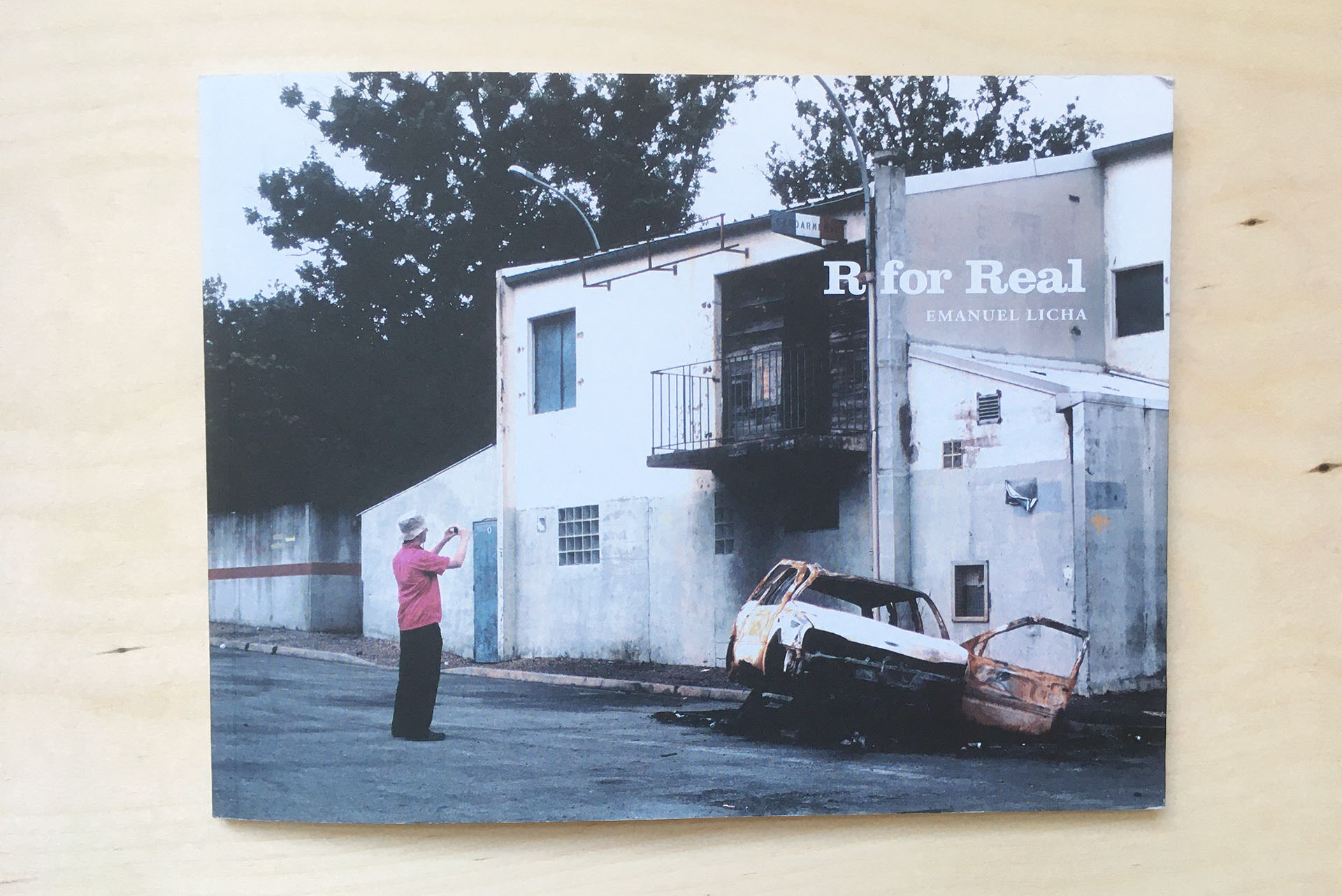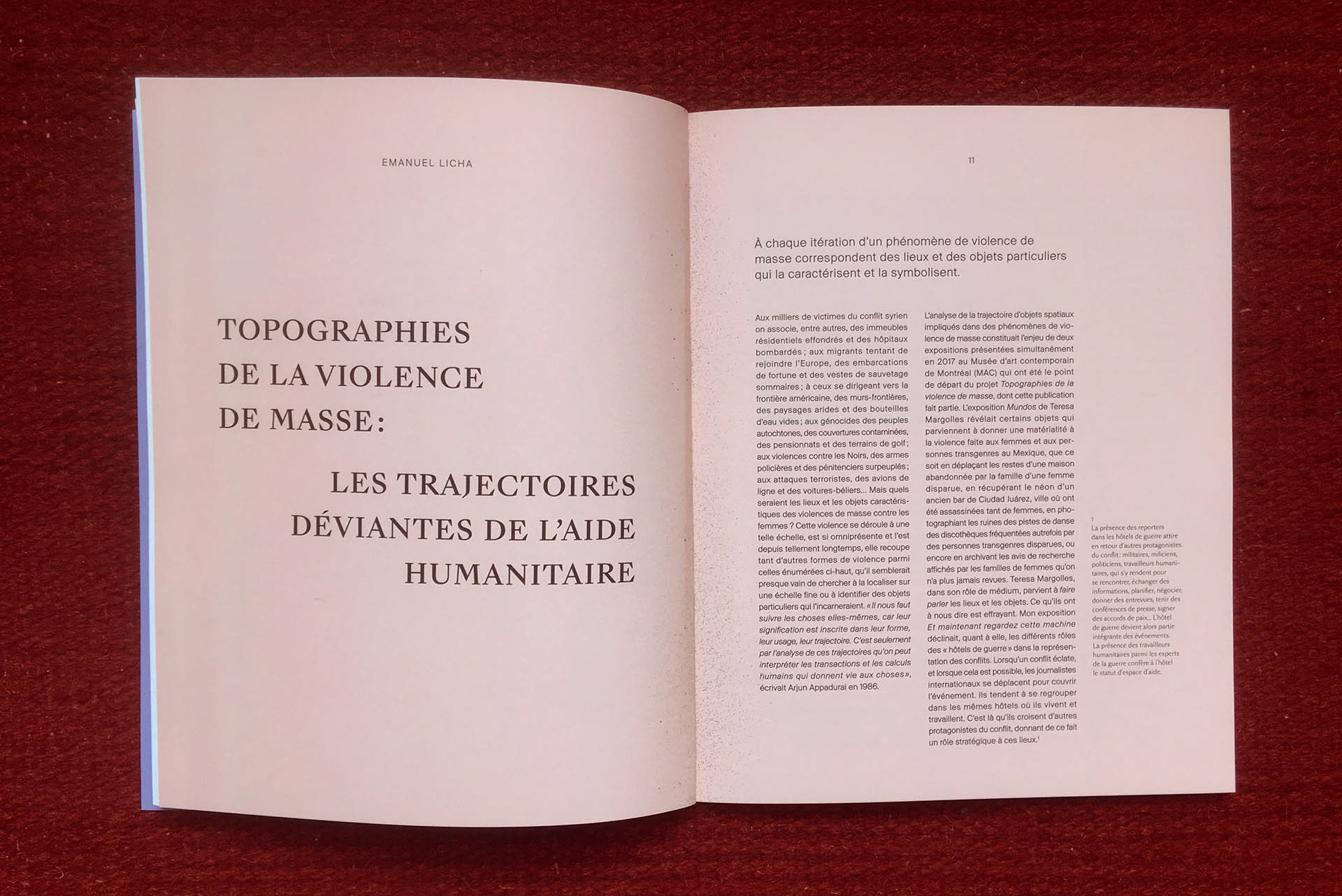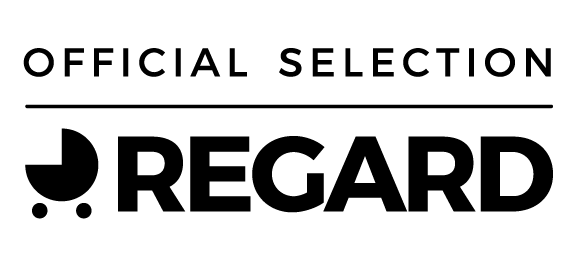

Creative documentary, 2024. 22 min.
Entretierra is a sonic space between life and death, between presence and absence, neither quite one nor the other. It's a space apart, where those who have disappeared can still tell their stories, and hear the living looking for them.
In Mexico, since the launch of the "war against drug trafficking" in 2006, the number of missing persons is estimated at over 112,000. Their families are organizing themselves to try to find them, dead or alive. Over time, these families have developed expertise in gathering information, reading soils and landscapes, archaeological excavation techniques, identifying bones, as well as in leading a militant struggle.
Credits
A research-creation project by Emanuel Licha and Luis López Aspeitia
Writing and direction: Emanuel Licha
Sound editing: Catherine Van Der Donckt
Sound design: David Drury
Sound recording: Martin de Torcy
Mixing: Martin Messier
Image: Gonzalo González Revilla
Editing: Emanuel Licha
Color grading: Ismaël Ouattara
Narrator: Luis Peinado
Production: Emanuel Licha
Sound editing: Catherine Van Der Donckt
Sound design: David Drury
Sound recording: Martin de Torcy
Mixing: Martin Messier
Image: Gonzalo González Revilla
Editing: Emanuel Licha
Color grading: Ismaël Ouattara
Narrator: Luis Peinado
Production: Emanuel Licha
With the financial support of the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada
Documentaire de création, 2024. 22 min.
Entretierra, c’est un espace sonore entre la vie et la mort, entre présence et absence, ni tout à fait l’un ni l’autre. C’est un espace à part, où celles et ceux qu’on a fait disparaître peuvent encore raconter leur histoire et entendre les vivant.e.s qui les cherchent.
Au Mexique, depuis le lancement de la «guerre contre le narcotrafic» en 2006, on estime le nombre de personnes disparues à plus de 112 000. Leurs familles s’organisent pour tenter de les retrouver, mort.e.s ou vivant.e.s, partout où leur espoir les mène : dans les prisons, les hôpitaux, les décharges publics, dans les banlieues et les déserts… Au fil du temps, elles ont développé des expertises dans la collecte de renseignements, la lecture des sols et des paysages, les techniques de fouilles archéologiques, l’identification d’ossements, mais aussi dans les façons de mener une lutte militante.
Crédits
Un projet de recherche-création de Emanuel Licha et Luis López Aspeitia
Écriture et réalisation: Emanuel Licha
Montage sonore: Catherine Van Der Donckt
Conception sonore: David Drury
Prise de son: Martin de Torcy
Mixage: Martin Messier
Image: Gonzalo González Revilla
Montage: Emanuel Licha
Colorisation: Ismaël Ouattara
Narration: Luis Peinado
Production: Emanuel Licha
Montage sonore: Catherine Van Der Donckt
Conception sonore: David Drury
Prise de son: Martin de Torcy
Mixage: Martin Messier
Image: Gonzalo González Revilla
Montage: Emanuel Licha
Colorisation: Ismaël Ouattara
Narration: Luis Peinado
Production: Emanuel Licha
Avec le soutien du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
Trailer | Bande-annonce
Director's Note
Despite the complexity of the subject, the film was to be a straightforward project. The idea was to imagine how a filmmaker - myself - and a social scientist - the Mexican sociologist Luis López Aspeitia - could produce a film together based on the latter's research field. Could the filmmaker's know-how and tools, combined with the sociologist's methodology, create a new kind of sensitive understanding of the issues surrounding enforced disappearances in Mexico?
Luis' long-established network of collaborators gave me easy, trusting access to groups of families organized into “search brigades” (Brigadas de búsqueda). We agreed together that we would accompany them on one of the searches they regularly organize across the country, filming them as little as possible to avoid their fear of images and reprisals, concentrating instead on their gestures, on the soundscapes of these times of searching and sharing between bereaved families, and also on the landscapes around Tijuana, which are both beautiful and anxiety-provoking.
The sounds, interviews and images accumulated, constituting rich and promising material for editing. But then came the difficulty, which for a time even became a stumbling block. Where to place the film's point of view and that of the viewer: on the side of the disappeared or on that of those seeking them? As the testimonies collected allowed us to feel as much the infinite grief of the families imagining what it would be like one day to be confronted with such misfortune, as the anguish of being the one who disappeared while waiting to be found, the decision was made to place ourselves - and the viewer with us - in an in-between position, between presence and absence, between light and darkness, between images and sounds.
The mother's account of her missing son's disappearance has been transformed into a first-person narrative - “They murdered me” says the voice in the introductory sequence - and then the whole film moves “underground”. What might look like (on computer screens or screenings in less-than-optimal conditions) long black sequences, is instead a textured space in which we perceive the grain of the image, i.e. what remains when there's nothing left to show. We emerge for a few brief moments to return to the side of those who seek, in the blinding light of northern Mexico, to show the immensity and harshness of the landscapes and of the task, quasi-Sisyphean.
This in-betweenness was largely sought in the sound dimension, with composer David Drury working both on the actual sounds of these places and actions, and on the frequencies perceived both on the surface of the ground and in its depths.
The result is a strange, hybrid film, which during its conception I called a “sound documentary with a few images”, an object designed above all to be listened to, without the images interfering with that listening.
Note du réalisateur
Ce film s’annonçait comme un projet simple, malgré la complexité du sujet. Il s’agissait d’imaginer comment un réalisateur – moi-même – et un chercheur en sciences sociales – le sociologue mexicain Luis López Aspeitia – pourraient produire un film ensemble à partir du terrain de recherche de ce dernier. Le savoir-faire et les outils du cinéaste s’associant à la méthodologie du sociologue parviendraient-ils à établir une connaissance sensible d’un nouveau type sur les enjeux des disparitions forcées au Mexique?
Le réseau de collaborateur.trices établi de longue date par Luis me donnait un accès facile et confiant à des collectifs de familles organisées en « brigades de recherche » (Brigadas de búsqueda). Nous avons convenu ensemble que nous les accompagnerions dans une des recherches de fosses qu’elles organisent régulièrement à travers le pays, en les filmant le moins possible pour déjouer leur crainte des images et des représailles, nous concentrant plutôt sur leurs gestes, sur les ambiances sonores de ces temps de recherche et de partage entre familles endeuillées, et aussi sur les paysages à la fois beaux et anxiogènes des environs de Tijuana.
Les sons, les entretiens, et les images se sont accumulées, constituant un matériel riche et prometteur pour le montage. C’est pourtant alors qu’est venu la difficulté, transformée même pendant un temps en blocage. Où placer le point de vue du film et celui de la spectatrice : du côté des disparu.e.s ou de celui de celles qui les cherchent? Comme les témoignages collectés permettaient de ressentir autant la peine infinie des familles en s’imaginant ce que serait être un jour confronté.e.s à pareil malheur, que l’angoisse d’être celui ou celle qui est disparu.e dans l’attente d’être retrouvé.e, la décision a été prise de se placer – et la spectatrice avec nous - dans un entre-deux, entre présence et absence, entre lumière et obscurité, entre images et sons.
Le récit de la mère racontant la disparition de son fils disparu a été transformé en récit à la première personne – « Ils m’ont assassiné » dit la voix dans la séquence d’introduction – puis tout le film passe ensuite « sous terre ». Ce qui risque de ressembler (sur des écrans d’ordinateur ou lors de projections dans des conditions non optimales) à de longues séquences de noirs, est plutôt un espace texturé dans lequel on perçoit le grain de l’image, c’est-à-dire ce qui reste lorsqu’il n’y a plus rien à montrer. On émerge à quelques brefs instants pour repasser du côté de celles qui cherchent, dans la lumière aveuglante du nord mexicain, pour montrer l’immensité et la dureté des paysages et de la tâche, quasi-sisyphéenne.
Cet entre-deux, nous l’avons cherché en grande partie dans sa dimension sonore, avec la recherche du compositeur David Drury travaillant à la fois sur les sons réels de ces lieux et de ces actions, que sur les fréquences perçues autant à la surface du sol que dans ses profondeurs.
De tout ce processus est né un film hybride, un peu étrange, que j’ai appelé durant sa conception un « documentaire sonore avec quelques images », un objet qui est surtout destiné à écouter sans qu’on puisse se passer des images qui viennent troubler cette écoute.